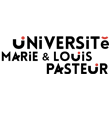Y4HPH9U5 : Philosophie générale et méthodologique
Entrer dans l’arène : L’intellectuel dans la cité
Pierre-Alexandre Crettez
Résumé du cours
La question du rapport du philosophe à la Cité – c’est-à-dire à ses concitoyens et à la vie collective – s’est posée avec acuité dès les origines de la philosophie. Si le philosophe peut s’adonner à la theoria sans encombre tant qu’il peut jouir du loisir de la skholê, rien ne garantit la possibilité ni l’efficience de cette pratique quand elle est menée dans d’autres espaces sociaux soumis à leurs contraintes propres. Quand le philosophe redescend dans la caverne, pressé par la clepsydre et par un public peu enclin à reconnaître son ignorance, il peine à se distinguer de ceux qui lui ressemblent le plus : les sophistes. Dès lors, si la philosophie est d’abord une manière de vivre, force est de constater que cette vie paraît impossible, puisqu’elle prétend incarner à modèle à suivre tout en s’aliénant l’opinion du plus grand nombre qu’elle ne cesse de confronter à ses contradictions.
Nous commencerons par un retour sur les différentes formes prises par ce « courage de la vérité » dans l’Antiquité (du procès de Socrate à la parrêsia cynique). Nous examinerons ensuite comment le problème de l’intervention de l’intellectuel sur la scène publique s’est posé à l’époque contemporaine. Le XXe siècle est en effet celui de « l’intellectuel engagé », agent social s’autorisant d’une compétence pourtant limitée (littérature, philosophie, sociologie) pour orienter le débat socio-politique.
Deux grandes questions guideront notre réflexion. (1) Peut-on échapper à la contradiction de l’engagement, celle à laquelle aboutit l’intellectuel lorsqu’il veut sauver son travail de la vanité en sortant de son isolement, mais en mettant alors en péril son autonomie intellectuelle ? (2) Cet engagement n’a-t-il pas pour effet de placer l’intellectuel dans une position de surplomb par rapport à son public ? Se faire le porte-parole d’un groupe, c’est parler pour lui, mais aussi à sa place, et c’est donc encore l’empêcher de parler.
Bibliographie indicative :
Les ouvrages en gras sont ceux dont la lecture est la plus conseillée (à choisir entre eux). Seules des éditions particulières sont ponctuellement recommandées.
Platon : Apologie de Socrate, GF, 2024 (consulter l’introduction de Luc Brisson, surtout sur l’elenchos socratique) ; Criton ; Euthyphron ; Gorgias ; La République ; Le Sophiste
- Diogène Laërce : Vie, doctrines et sentences des philosophes illustres : Les Sept sages ; Socrate ; Platon ; Les Cyniques.
- Épictète, Entretiens, III, XXII, « Du cynisme ».
- Descartes : Discours de la méthode (III).
- Kant : Qu’est-ce que les Lumières ? ; Le Conflit des facultés ; Qu’est-ce qu’un livre ?, U. F. 1995 (avec une présentation de Jocelyn Benoist).
- Weber : « La profession et la vocation de savant », in Le Savant et le Politique, Paris, Éditions de la découverte, tr. C. Colliot-Thélène, 2003.
- Benda, La trahison des clercs.
- Nizan, Les Chiens de garde ; « III. Le philosophe » et « IV. Le journaliste » in Paul Nizan, Intellectuel communiste, II, Paris, éd. Maspero, 1970.
- Sartre : Qu’est-ce que la littérature ? ; « La responsabilité de l’écrivain » (1946), in Situations II, Gallimard, 1948, et repris dans La responsabilité de l’écrivain, Lagrasse, Verdier, 1998 ; « Les communistes et la paix » (in Situations, IV).
- Merleau-Ponty : Humanisme et Terreur, Gallimard, 1948 ; Éloge de la philosophie, Gallimard, 1953 ; Les Aventures de la dialectique, Gallimard, 1955 (réédité en 2024) ; Signes (« Le Philosophe et son ombre » ; « Propos » : I à XIV), Gallimard, 1960.
- Claire Dodeman, La philosophie militante de Merleau-Ponty, Ousia Eds, 2023.
- Aron : L’opium des intellectuels, éd. Calmann Lévy, 2004 [1955] ; D’une sainte famille à l’autre. Essai sur le marxisme imaginaire, Gallimard, 1969.
- Castoriadis : Le monde morcelé. Les carrefours du Labyrinthe 3, Éditions du Seuil, 1990, « Les intellectuels et l’histoire », « La “fin” de la philosophie ? ».
- Vernant : Les origines de la pensée grecque, IV-V, VIII, P.U.F., 2013 ; Mythe et pensée chez les Grecs, t. II, « 7. Du mythe à la raison. La formation de la pensée positive dans la Grèce archaïque », éd. Maspero, 1974.
- Foucault : Le Courage de la vérité. Le gouvernement de soi et des autres (1984), Paris, éd. du Seuil, 2009 ; « Le courage de la vérité : l’ascète, le révolutionnaire et l’artiste », in Esprit, 2008/12 (Décembre), p. 51-60).
- Bourdieu : « Champ intellectuel et projet créateur », in Les temps modernes, novembre 1966, 865-906 ; Homo academicus ; « La délégation et le fétichisme politique », « L’identité et la représentation » (in Langage et pouvoir symbolique) ; Le Sens pratique, Éditions de Minuit, 1980 ; « Le hit-parade des intellectuels français ou qui sera juge de la légitimité des juges ? », in Actes de la recherche en sciences sociales, 1984, n° 52-53, p. 95-100 (repris dans Homo academicus en annexe) ; Méditations pascaliennes, Éditions du Seuil, 1997 ; Sur la télévision ; suivi de L’emprise du journalisme, éd. Raisons d’agir, 1996, ; Interventions, 1961-2001, éd. Agone, 2022.
- Descombes : Philosopher par gros temps, Éditions de Minuit, 1989.
- Rancière : Le Philosophe et ses pauvres, Flammarion, 2007 ; Le Maître ignorant : Cinq leçons sur l’émancipation intellectuelle, Fayard, 2004.
- Serge Halimi : Les Nouveaux chiens de garde, éd. Raisons d’agir, 2005.
- Benoît Denis : Littérature et engagement, de Pascal à Sartre, Paris, éd. du Seuil, 2000.
- Nathalie Heinich, Ce que le militantisme fait à la recherche, Paris, éd. Gallimard, coll. « Tracts» (n°29), 2021.