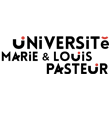Le laboratoire Logiques de l’Agir a le plaisir de vous convier à la douzième séance doctorale de son séminaire le mercredi 19 février 2025 de 18h00 à 20h00, en salle E14 (Grand Salon), entrée par le 18 rue Chifflet, 25000 Besançon.
Interviendront : Florian Vandelle et Lucas Peutot.
Florian Vandelle : La révolution symbolique selon Pierre Bourdieu
Résumé
Théoricien de la reproduction sociale, Pierre Bourdieu l’est aussi du changement, comme l’attestent ses enquêtes diachroniques portant sur les transformations de la paysannerie en Algérie et en Béarn, sur la genèse de l’État moderne ou encore sur l’évolution des pratiques culturelles françaises depuis le XIXe siècle. Pour rendre compte scientifiquement de ces dynamiques temporelles, le sociologue élabore différents modèles théoriques à portée générale dont il est possible d’établir une typologie.
Dans le cadre de cette présentation, on se penchera plus précisément sur le modèle que Bourdieu consacre à un type particulier de bouleversement interne aux champs, ces « microcosmes sociaux hiérarchisés et relativement autonomes » qui mettent en scène des luttes de concurrence pour des enjeux spécifiques. Ce modèle est fondé sur la notion de révolution symbolique, qui désigne une subversion volontaire, par un ou plusieurs agents, des normes constitutives d’un champ en vue d’y instaurer de nouvelles règles et de nouveaux enjeux.
S’attaquant aux principes de vision et de division du monde social – distinctions, classements et hiérarchies – que les représentations dominantes tendent à naturaliser, la révolution symbolique opère un désajustement des structures cognitives vis-à-vis des structures objectives qui a pour effet de rompre l’adhésion spontanée des individus aux logiques arbitraires de l’ordre social. Ce faisant, elle rend possible une transformation radicale non seulement des pratiques, mais également des dispositions qui fondent ces dernières.
À partir de l’étude de cas que Bourdieu a menée au sujet de la révolution symbolique de l’art moderne, incarnée par la figure d’Édouard Manet, on abordera les enjeux philosophiques soulevés par cette notion, qu’ils soient épistémologiques (concernant la connaissance sociologique du changement social) ou politiques (concernant les conditions d’une action subversive rationnelle). En suivant certains développements de son avant-dernier cours au Collège de France, on examinera en particulier la solution originale que Bourdieu apporte au problème suivant : comment penser une transformation volontaire des catégories de perception, d’appréciation et d’évaluation du monde social qui sont le produit de ce même monde ?
Lucas Peutot : Fondements métaphysiques de la vulnérabilité : réflexion contemporaine sur la pensée schopenhaurienne
Résumé
Si la vulnérabilité est généralement envisagée à travers des prismes biologiques, sociaux ou éthiques, elle peut également être pensée comme une structure fondamentale de l’existence. En s’appuyant sur la philosophie de Schopenhauer, nous proposons d’examiner la vulnérabilité non plus comme une caractéristique accidentelle des êtres vivants, mais comme une nécessité ontologique.
En identifiant la volonté comme le principe métaphysique premier, Schopenhauer décrit une existence marquée par la souffrance, où tout être vivant est exposé à une blessure constitutive, préalable à toute interaction sociale ou physiologique. De par cette blessure, la vulnérabilité n’est plus seulement à envisager sous le spectre unique de la fragilité physique ou de la dépendance relationnelle : il faut la concevoir comme inscrite dans l’essence même du vivant. À partir de cette perspective, nous verrons que là où les théories du care et les approches anthropologiques insistent sur la vulnérabilité en tant que donnée contextuelle et relationnelle, la pensée de Schopenhauer invite à en faire une structure première de l’être. Cette vulnérabilité ontologique, loin d’être une simple condition du corps ou des rapports sociaux, s’enracine dans la dynamique même de la volonté et de ses caractères, faisant de la chose en soi, une instance vulnérabilisante. Cette dernière, en s’exprimant dans le phénomène, en fera nécessairement un phénomène vulnérable.
Dans le cadre de cette présentation, nous nous pencherons plus spécifiquement sur le rapport entre volonté et corps pour éclairer le lien causale de vulnérabilité entre la volonté et le phénomène, notamment au niveau ontologique. En mobilisant la notion schopenhauerienne de double connaissance du corps — à la fois phénomène inscrit dans la représentation et expression immédiate de la volonté — nous montrerons comment la vulnérabilité ne se réduit pas à une donnée observable, mais se vit d’abord comme une expérience intime et irréductible. Cette réflexion nous permettra également d’interroger la manière dont l’individu prend conscience de sa propre vulnérabilité à travers le désir… et la souffrance qui en découle.