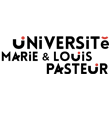Y4HPH0U1 : Philosophie des pratiques
La folie en pratiques : la paranoïa, entre geste motivé et diagnostic psychiatrique
Dylan Guével
Résumé du cours
La catégorie de paranoïa a trouvé une nouvelle vigueur ces dernières années face à la question des « complotismes », en particulier aux Etats-Unis. L’usage de cette notion psychiatrique pour traiter d’un phénomène d’ordre social n’est pas nouveau, et pose un certain nombre de questions. Ce cours partira de l’idée qu’on ne peut guère approcher les phénomènes en question sans en passer par l’étude de deux registres de pratiques.
Il s’intéressera d’abord à ce que font, et ce dont se réclament les individus qui sont étiquetés comme paranoïaques : des pratiques d’enquête, d’interprétation, de mise en cohérence, de dénonciation, de critique et de contestation. On essayera de montrer que, loin d’être des opérations intellectuelles éthérées, ces « activités » cognitives engagent des prises de positions dans des milieux sociaux et des institutions, et des dispositions subjectives particulièrement valorisées chez les individus modernes. On s’efforcera, en mobilisant des outils de philosophie de l’esprit, de saisir jusqu’où peut aller une interprétation charitable des comportements qui peuvent être étiquetés comme paranoïaques en les rapportant à des formes au moins partielles de rationalité socialement intégrée.
Le deuxième axe interrogera les pratiques psychiatriques qui entourent le diagnostic de paranoïa. En partant cette fois d’une philosophie de la psychiatrie comme science, qui donne sa place aux contextes institutionnelles et politiques, on s’interrogera sur les intérêts et les limites des définitions et explications qui ont été données à la paranoïa au XXe siècle. On finira en s’efforçant de faire communiquer les deux branches de l’analyse dans une réflexion sur la signification politique et anthropologique de l’existence de la paranoïa dans les sociétés contemporaines.
Bibliographie
Une bibliographie plus extensive de toutes les références sera donnée pendant le cours. Celle-ci indique les références principales :
Un personnage littéraire qui pose des questions :
von Kleist Heinrich, Michel Kohlhaas, Flammarion, 1998
Deux classiques de la psychiatrie sur la paranoïa :
Sérieux et Capgras, Les Folies raisonnantes, Félix Alcan, 1909 – particulièrement l’introduction et le premier chapitre
Freud Sigmund, Le Président Schreber, un cas de paranoïa, Payot, 2013
A lire avec l’ouvrage du principal concerné : Schreber Daniel Paul, Mémoires d’un névropathe, Point, 1985
En philosophie et histoire de la psychiatrie :
Foucault Michel, Maladie mentale et psychologie, PUF, 1954
Foucault Michel, Histoire de la folie à l’âge classique, Gallimard, 1961
Swain Gladys, « De Kant à Hegel : Deux époques de la folie », in Dialogue avec l’insensé – Essais d’histoire de la psychiatrie, Gallimard, 1997
Gregson William, « The Sociality of Madness: Hegel on Spirit’s Pathology and the Sanity of Ethicality », Hegel Bulletin 45/3
Des interprétations de la paranoïa par la perspective sociale :
Adorno et Horkheimer, Dialectique de la raison, en particulier « 5. L’antisémitisme », Gallimard, 1983
Boltanski Luc, Enigmes et complots, Gallimard, 2012
Lemert Edwin, « The Concept of Secondary Deviation », Human Deviance, Social Problems and Social Control, 1967
Pour la question de la « compréhension » :
Winch Peter « Understanding a Primitive Culture », in Ethics and Action, Routledge & Kegan Paul, 1972
En Français, on peut regarder :
Winch Peter, L’Idée d’une science sociale, Gallimard, 2009