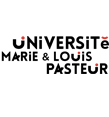Y4HPH2U1 : Histoire de la philosophie 1
Introduction à l’œuvre de Rousseau
Armelle Chupeau
Résumé du cours
Le cours sera une introduction à la pensée de Rousseau afin d’en analyser les différents aspects, à la fois politiques, sociaux, moraux, anthropologiques et littéraires. S’il ne fait aucun doute que Rousseau occupe une place centrale dans la pensée moderne en tant que philosophe des Lumières, il fait aussi figure de marginal. L’homme a suscité dès le début de sa carrière littéraire tant des réactions d’adhésion que de vifs rejets. Sa pensée est traversée de tensions problématiques : faisant tour à tour l’éloge de la nature, de la solitude dans le Second Discours ou encore dans les Rêveries mais aussi l’analyse des bienfaits de la communauté dans le Contrat social. Comme il le dit lui-même : « Après mon premier Discours, j’étais un homme à paradoxes, qui se faisait un jeu de prouver ce qu’il ne pensait pas ; après ma Lettre sur la musique française, j’étais l’ennemi déclaré de la nation […] ; après mon Discours sur l’inégalité, j’étais athée et misanthrope, après la Lettre à M. D’Alembert, j’étais le défenseur de la morale chrétienne, après l’Héloïse, j’étais tendre et doucereux ; maintenant je suis un impie ; bientôt peut-être serai-je un dévot » (Lettre à Christophe de Beaumont). Ces tensions sont alors propices à des contresens sur sa pensée ou à des réductions à des lieux communs comme la croyance naïve en la bonté naturelle de l’homme. Le cours s’attachera dès lors à élucider deux axes problématiques :
– Si la cohérence des principes pose problème dans la pensée de Rousseau, peut-on véritablement lui reconnaître le statut de « philosophie » ? Si Rousseau affirme ne parler « ni en savant ni en philosophe » mais en « homme simple, ami de la vérité, sans parti, sans système » (Émile, II) ; il redéfinit ce qu’il appelle « raisonner en philosophe ». Comment le comprendre ?
– Dans quels domaines choisit-il alors d’établir les principes fondamentaux de son
système ? Quelle place fait-il aux traditions qu’il discute et dont il s’inspire ?
Bibliographie
Cette bibliographie est indicative et contient les œuvres majeures sur lesquelles le cours prendra appui ainsi que les études canoniques dont il faudra prendre connaissance pour préciser la lecture des textes.
– Œuvres principales
Discours sur les sciences et les arts (1750), édition GF.
Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité parmi les hommes (1755), édition GF.
Lettre à D’Alembert sur les spectacles (1758).
Du contrat social (1762), édition GF.
Émile ou De l’éducation (1762), plus particulièrement la « Profession du vicaire savoyard » (livre IV), Éd. GF ou PUF Quadrige.
Lettre à Christophe de Beaumont (1763).
Lettres écrites de la Montagne (1764).
Les Confessions (écrites de 1765 à 1770, publication posthume), Éd. GF ou Folio classique.
Les Rêveries du promeneur solitaire (écrites en 1776, publication posthume).
Essai sur l’origine des langues (1755, inachevé, publié à titre posthume en 1781).
– Ouvrages contemporains et commentateurs
Charrak A., Rousseau. De l’empirisme à l’expérience, Paris, Vrin, 2013.
Goldschmidt V., Anthropologie et politique. Les principes du système de Rousseau, Paris, Vrin, 1974.
Gouhier H., Les méditations métaphysiques de J.-J. Rousseau, Paris, Vrin, 1970.
Manent P., Naissance de la politique moderne, Paris, Payot, 1977.
Spector C., Rousseau. Les paradoxes de l’autonomie démocratique, Paris, Michalon, 2015.
Starobinski J., J.-J. Rousseau, La transparence et l’obstacle, Paris, Gallimard, 1971.
Strauss L., Droit naturel et histoire (1953), trad. Fr. M. Nathan et E. de Dampierre, Paris, Flammarion, 1986.