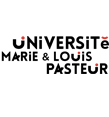Y4HPH9U2 : Philosophie contemporaine
Langage et formes de vie. Regards croisés entre la phénoménologie de Merleau-Ponty et le pragmatisme de Wittgenstein
Nicolas Antoszkiewicz
Résumé du cours
Le langage est généralement considéré comme le support expressif, le moyen de communication d’une pensée. En effet, la Grammaire générale et raisonnée de Port-Royal s’ouvre sur cette définition : « Parler est expliquer ses pensées par des signes que les hommes ont inventés à ce dessein ». Selon cette conception, le langage ne contribuerait pas à la formation des pensées mais il se contenterait de les déployer dans l’élément de l’extériorité pour les transmettre à autrui. Or, s’il y a un point commun à ces deux philosophies majeures du XXe siècle que sont la phénoménologie de Maurice Merleau-Ponty et le pragmatisme linguistique de Ludwig Wittgenstein, il est justement à trouver dans une critique de cette idée d’un domaine privé de la pensée antérieur à son inscription dans la chair du langage. En effet, ces deux penseurs réhabilitent tous deux – bien que de manière différente – l’idée d’un primat du langage sur la pensée, au sens où le langage s’enracinerait dans des formes de vie pratiques et sensibles. Ce cours consistera à mettre en rapport ces deux penseurs en tant que propositions théoriques les plus abouties du pragmatisme et de la phénoménologie. A travers cette étude croisée, notre objectif sera de définir ces propositions – par leurs divergences – comme les coordonnées du problème contemporain du langage, telles qu’elles se cristallisent notamment dans le débat autour des nouveaux réalismes (cf. Nouvelle philosophie en Allemagne et en France, J. Benoist, M. Gabriel et J. Rometsch (dir.), 2023). Il s’agira notamment d’évaluer l’opposition entre langage ordinaire et langage poétique dans leur capacité respective à être la forme la plus fondamentale du langage. A travers cette opposition se dessinent deux chemins radicalement différents pour caractériser la forme de vie humaine : la voie cosmologique d’une communication sensible entre les différents êtres du monde et la voie anthropologique d’une communication réservée aux hommes qui participent aux mêmes champs pratiques. Pour cela, nous tenterons dans un premier temps d’établir la généalogie du problème du rapport entre langage et formes de vie chez Husserl, Frege et le premier Wittgenstein.
Bibliographie primaire
FREGE Gottlob, Écrits logiques et philosophiques, Paris, Seuil, 1971.
HUSSERL Edmund, Expérience et jugement, Paris, PUF, 1970.
HUSSERL Edmund, L’origine de la géométrie, Paris, PUF, 1962.
HUSSERL Edmund, Recherches logiques. Tome 2, Deuxième partie, Paris, PUF, 1972.
HUSSERL Edmund, Sur le Renouveau, Paris, Vrin, 2005.
MERLEAU-PONTY Maurice, Éloge de la philosophie, Paris, Gallimard, 1953.
MERLEAU-PONTY Maurice, La prose du monde, Paris, Gallimard, 1969.
MERLEAU-PONTY Maurice, Phénoménologie de la perception, Paris, Gallimard, 2004.
MERLEAU-PONTY Maurice, Sens et non-sens, Paris, Gallimard, 1948.
MERLEAU-PONTY Maurice, Signes, Paris, Gallimard, 1960.
RUSSELL Bertrand, Signification et vérité, Paris, Champ, 2013.
WITTGENSTEIN Ludwig, De la certitude, Paris, Gallimard, 2006.
WITTGENSTEIN Ludwig, Recherches philosophiques, Paris, Gallimard, 2004.
WITTGENSTEIN Ludwig, Tractatus logico-philosophicus, Paris, Gallimard, 1993.
Une bibliographie avec des œuvres de littérature secondaire sera fournie lors du premier cours.