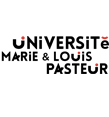Y4HPH1U2 : Philosophie de l’art
Mais que font les artistes ? Faire une œuvre d’art
Pierre-Alexandre Crettez
Résumé du cours
La philosophie de l’art est traditionnellement nommée esthétique (de aisthêsis : sensation) parce que son premier objet est devenu le beau, et sa première question celle de l’objectivité ou de la subjectivité du sentiment d’un spectateur devant une œuvre d’art. Ce cours propose cependant de changer l’orientation de l’analyse pour se concentrer sur ce que fait l’artiste, et non sur ce que fait l’œuvre au spectateur. La réflexion sur l’art devient alors une poïétique (de poïen : faire, produire) se donnant pour thème la nature de la création.
On essaiera d’abord comprendre pourquoi la philosophie a si peu essayé de rendre raison de l’activité de l’artiste. Ce dernier est en effet rendu mystérieux, et donc incompréhensible : on le dit « inspiré » par une force supérieure, avoir reçu la grâce du « génie », ou créer ex nihilo comme le Dieu tout-puissant des monothéismes. Cette question nous conduira à éclaircir ce que signifie « inventer » en général et dans l’art en particulier. Comment comprendre que les êtres humains puissent rendre effectif ce qui était auparavant inconcevable, sans céder à la tentation de faire venir ce pouvoir d’une force surnaturelle ?
Bibliographie indicative : Les ouvrages en gras sont ceux dont la lecture est la plus conseillée (à choisir entre eux). Seules des éditions particulières sont ponctuellement recommandées.
- Platon : Apologie de Socrate ; Ion ; La République (II, III, X), Le Sophiste
- Aristote : Poétique
- Alberti : De la peinture
- Léonard : Traité de la peinture
- Vasari : Les Vies des meilleurs peintres, sculpteurs et architectes
- Panofsky : Contribution à l’histoire du concept de l’ancienne théorie de l’art, Gallimard, 1989 ; La Perspective comme forme symbolique, Éditions de Minuit, 1976 ; Architecture gothique et pensée scolastique (avec une postface de Bourdieu), Éditions de Minuit, 1967 ; L’Œuvre d’art et ses significations, Gallimard, 1969.
- Kant : Critique de la faculté de juger ; Qu’est-ce qu’un livre ?, U. F. 1995 (avec une présentation de Jocelyn Benoist).
- Nietzsche : La Naissance de la tragédie ; Humain trop humain (IV, § 155, 162)
- Alain : Système des beaux-arts, Gallimard, 1920.
- Heidegger : « L’origine de l’œuvre d’art » (in Chemins qui ne mènent nulle part, Gallimard, 1962).
- Sartre : Qu’est-ce que la littérature ?, in Situations II, Gallimard, 1948.
- Lévi-Strauss, « La science du concret » (sur le « bricolage »), in La Pensée sauvage, Plon, 1962.
- Merleau-Ponty : « Le doute de Cézanne » (in Sens et non-sens, Nagel, 1948) ; La Prose du monde, Gallimard, 1969 ; Le Monde sensible et le monde de l’expression. Cours au Collège de France : notes, 1953, Métis Presse, 2011.
- Bourdieu : Un art moyen : Essai sur les usages sociaux de la photographie, Éditions de Minuit, 1965 ; Les Règles de l’art : genèse et structure du champ littéraire, Éditions du Seuil, 1992 ; Sur Manet : une révolution symbolique, Éditions du Seuil, 2013 ; « Dialogue sur la poésie orale en Kabylie» (avec Mouloud Mammeri), in Actes de la recherche en sciences sociales, 1978 (sur Persée).